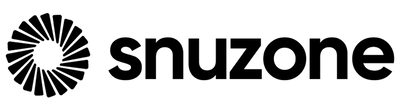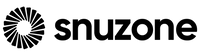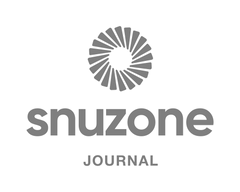Arrêter de fumer – beaucoup considèrent cela comme une entreprise difficile. Cependant, ce ne sont généralement pas seulement les symptômes du sevrage nicotinique qui rendent l’arrêt difficile. Ceux-ci peuvent être maîtrisés à l’aide de médicaments ou de substituts nicotiniques. Ce sont plutôt les dynamiques psychosociales qui jouent un rôle essentiel. De nombreux facteurs sociaux peuvent favoriser la consommation et compliquer l’arrêt – par exemple, l’appartenance à un groupe et la convivialité liée au tabac dans son entourage. Cela est particulièrement vrai lorsque des facteurs psychologiques agissent également comme de puissants moteurs – en particulier, les « schémas inadaptés », c’est-à-dire des modèles cognitifs et comportementaux dysfonctionnels, peuvent alimenter défavorablement la consommation lorsque des stimuli déclencheurs sont présents.
>> En savoir plus sur : Médicaments pour arrêter de fumer
Les raisons d’un arrêt difficile sont donc complexes et ne peuvent pas être réduites uniquement à d’éventuels symptômes de sevrage. Le modèle biopsychosocial suggère qu’il faut envisager au moins trois niveaux où se trouvent des facteurs favorisant, interagissant mutuellement, pour l’initiation, le maintien et finalement la difficulté de l’arrêt du tabac. Un abus de nicotine peut ainsi être compris de manière holistique.
Les méthodes psychothérapeutiques abordent ces aspects psychosociaux – un exemple en est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Et bien qu’elle ne puisse jamais remplacer une psychothérapie professionnelle, certaines techniques d’auto-assistance peuvent en être dérivées.
Techniques d’auto-assistance issues de la psychothérapie comme remèdes maison pour arrêter de fumer
Les remèdes maison pour arrêter de fumer sont généralement compris comme de simples moyens domestiques et mesures d’automédication. Plus généralement, cependant, un remède maison peut aussi être une forme de solution ou d’aide appliquée soi-même à domicile pour l’arrêt du tabac.
Dans ce sens, les techniques d’auto-assistance issues de la psychothérapie sont considérées comme des remèdes maison, l’accent étant mis moins sur « l’automédication » que sur « l’auto-intervention ».
La thérapie cognitivo-comportementale est une école de psychothérapie qui offre un soutien efficace dans les cas de dépendance à la nicotine et lors du sevrage tabagique, et peut apporter des solutions durables. Dans le cadre de son approche, il est possible de dériver des techniques que le patient peut appliquer lui-même pour soutenir l’abstinence – et celles-ci peuvent aider à assouplir, déconstruire et finalement modifier des schémas de consommation et de comportement rigides et défavorables ainsi que leurs conditions.
Analyse comportementale situationnelle : Modèle SORKC
Pour pouvoir modifier/cesser durablement son comportement de consommation, il semble essentiel de comprendre quels déclencheurs alimentent la consommation et pourquoi ils le font. Il peut également être utile de se rappeler quelle valeur psychosociale apporte le tabagisme – la consommation peut ici être comprise de manière fonctionnelle. Les fumeurs ressentent généralement des conséquences positives immédiates de leur consommation – les fameux renforçateurs. En ce sens, le tabagisme est considéré comme un « phénomène téléologique », un comportement orienté vers un but et renforcé simplement par l’objectif à atteindre (compris au sens psychosocial).
En thérapie cognitivo-comportementale, l’analyse comportementale initiale est considérée comme un moment clé pour l’application ultérieure des méthodes thérapeutiques. On distingue entre une analyse comportementale contextuelle/verticale et situationnelle/horizontale.*1
 |
Grâce à une analyse comportementale, on peut d’abord obtenir un aperçu des interactions complexes entre cognition, émotion et comportement, ce qui permet d’éclaircir les dynamiques psychosociales. - © Image : AdobeStock |
En particulier, l’analyse comportementale horizontale peut clarifier de manière assez simple dans quelle mesure un comportement de consommation est lié à des stimuli situationnels, à des schémas inadaptés individuels et aux conséquences associées à la consommation. Ensuite, des méthodes spécifiques peuvent être dérivées, qui abordent différents aspects et apportent une aide pour arrêter de fumer.
Le modèle SORKC dans l’arrêt du tabac
Un concept reconnu de l’analyse comportementale horizontale est le modèle dit SORKC.*2 Ce modèle est mentionné pour montrer dans quelle mesure les techniques d’auto-assistance prévues peuvent être dérivées, et surtout, pourquoi et de quelle manière elles fonctionnent.
Le schéma SORKC se compose de cinq variables :
| S ---> | O ---> | R ---> | K ---> | C |
- Stimulus (S): Comprend les stimuli (clés) liés à la situation qui précèdent un comportement (de consommation).
- Organisme (O): Comprend les bases biologiques et l’histoire d’apprentissage d’une personne – cela inclut également les croyances fondamentales, attentes et besoins importants des schémas inadaptés mentionnés, qui, lorsqu’ils sont activés/évités/surcompensés par un déclencheur dans la variable stimulus, conduisent à des réactions rigides dans la variable réaction.
- Réaction (R): Regroupe toutes les réactions observables (comportement visible) et non observables (cognitives, émotionnelles et physiologiques), qui, en raison de facteurs issus de la variable organisme, suivent des stimuli situationnels. La classification en styles d’adaptation inadaptés (fuite, combat, sidération) peut montrer si les schémas inadaptés ont été évités, surcompensés ou activés.
- Contingence (K): Exprime la fréquence de la cooccurrence de la situation, du comportement et des conséquences.
- Conséquence (C): Toutes les récompenses et punitions résultant du comportement.
Que sont les schémas inadaptés ?
Les schémas inadaptés sont un concept développé par Jeffrey Young, qui peut être décrit comme suit :
Selon Jeffrey Young, des schémas inadaptés peuvent se développer lorsque des besoins émotionnels fondamentaux durant l’enfance et l’adolescence ne sont pas satisfaits ou sont frustrés à plusieurs reprises. Dix-huit schémas différents ont été cliniquement et empiriquement confirmés, répartis en cinq domaines (ou thèmes) qui reflètent à leur tour le besoin fondamental frustré.
Le schéma est donc établi au cours du développement individuel précoce comme un modèle durable et global de sentiments, pensées, souvenirs et sensations corporelles, au sens d’une « image intérieure » des conditions réelles de la biographie précoce. Ce modèle peut se renforcer au fil du développement et continuer à orienter le comportement lorsqu’il est activé, même si les conditions extérieures et le réseau relationnel changent."*3
Selon therapie.de, les schémas inadaptés sont également décrits comme suit :
"Un schéma englobe des modèles durables et défavorables de sentiments, pensées et souvenirs qui orientent le comportement dans une situation donnée. Les schémas peuvent concerner la personne elle-même (schémas du soi) ou ses relations avec les autres (schémas relationnels). Ils ont un impact négatif sur la vie de la personne et sont donc également appelés « pièges de vie »."*4
En complément, il convient de noter que de tels schémas déterminent largement la perception du contenu situationnel.
Par des croyances fondamentales, attentes (envers soi-même ou envers les autres) et besoins importants défavorables, ces schémas inadaptés peuvent représenter des facteurs directeurs sur la Variable Organisme. Les "réactions inadaptées" correspondantes, observables et non observables (fuite, combat, sidération), qui résultent de croyances, attentes et besoins défavorables et directeurs des schémas, se retrouvent finalement dans la Variable Réaction. Les stimuli clés, par lesquels les schémas inadaptés sont activés, évités ou surcompensés, peuvent quant à eux être clarifiés dans la Variable Stimulus en lien avec la situation.
Avec ce concept, des schémas comportementaux dysfonctionnels peuvent ainsi être reliés à leurs stimuli clés, aux composantes cognitives et émotionnelles défavorables activées/évitées/surcompensées par ceux-ci, et aux conséquences qui en résultent. Cela permet de reconnaître et comprendre ce qui alimente et guide son comportement de consommation dans le cas du tabac, et où des approches de modification peuvent être envisagées.
Voici maintenant une liste des 18 schémas inadaptés – avec leurs Croyances fondamentales (CF), Attentes (A) et Besoins (B) typiques respectifs, tels qu’ils peuvent être saisis dans la Variable Organisme*5 :
- Abandon/Instabilité
- Les autres sont peu fiables/instables. (CF)
- Je serai abandonné/laissé seul. (A)
- Attachement et stabilité (B) - Méfiance/Abus
- Les autres ne sont pas honnêtes, ils profitent de moi/sont manipulateurs/me blessent. (CF)
- Je serai trompé/trahi/humilié/exploité/manipulé. (A)
- Sécurité et confiance (B) - Privation émotionnelle
- Les autres ne peuvent pas soutenir émotionnellement/ne donnent pas d’affection, d’attention/de compréhension/de protection. (CF)
- Je serai rejeté/non compris/non protégé. (A)
- Affection, empathie et protection (B) - Imperfection/Honte
- Je suis imparfait/mauvais/indésirable/inférieur/incapable. (CF)
- Je ne serai pas aimé, respecté, inclus ; je serai désavantagé, humilié. (A)
- Amour, respect et estime de soi (B) - Isolement social/Alienation
- Je suis fondamentalement différent des autres. (CF)
- Je n’appartiendrai pas/je serai exclu. (A)
- Appartenance, intégration dans la communauté (B) - Dépendance/Incompétence
- Je ne peux rien gérer sans aide. (CF)
- Cela va me submerger ; je n’y arriverai pas sans soutien. (A)
- Indépendance, compétence (B) - Vulnérabilité aux dommages ou à la maladie
- Quelque chose de grave va arriver. (CF)
- Je serai en danger, impuissant. Je perdrai le contrôle. (A)
- Sécurité, évaluation réaliste des risques (B) - Enchevêtrement / Soi non développé
- Sans proximité extrême avec les autres, je suis perdu. (CF)
- Sans attachement, je serai désorienté. (A)
- Autonomie, identité, objectifs personnels (B) - Échec
- Je suis incapable, stupide, inférieur en performance. (CF)
- L’échec futur est inévitable. (A)
- Réussites, confiance en soi (B) - Droits excessifs/Grandiosité
- Je suis supérieur aux autres, j’ai des droits particuliers. (CF)
- Les autres doivent se soumettre à mes besoins. Succès, pouvoir et célébrité. (A)
- Reconnaissance de limites réalistes, empathie (B) - Autocontrôle/Discipline insuffisants
- Je peux céder à mes impulsions ; éviter l’effort. (CF)
- Les autres s’en occuperont. (A)
- Autocontrôle, meilleure tolérance à la frustration (B) - Soumission
- Je dois me soumettre/m’adapter aux autres pour éviter les conflits. (CF)
- Si je montre mes propres besoins/émotions, je serai rejeté ou puni. (A)
- Affirmation de soi, autonomie (B) - Sacrifice de soi
- Les besoins des autres sont plus importants que les miens. (CF)
- Si je prends soin de moi, je me sens coupable/je serai abandonné. (A)
- Équilibre entre soin aux autres et soin de soi (B) - Recherche d’approbation et de reconnaissance
- Ce n’est que par la performance, l’adaptation ou l’attrait que j’ai de la valeur. (CF)
- Si je ne plais pas, je serai rejeté. (A)
- Estime de soi stable, authenticité (B) - Négativité/Pessimisme
- La vie est pleine de dangers, de déceptions et de pertes. (CF)
- Le malheur arrivera, le bien est trompeur. (A)
- Optimisme, espoir, équilibre entre positif et négatif (B) - Inhibition émotionnelle
- Montrer ses émotions est dangereux ou embarrassant. (CF)
- Critique, rejet, honte lors d’une expression spontanée. (A)
- Liberté d’exprimer ses émotions, spontanéité (B) - Standards élevés/Perfectionnisme
- Je dois toujours être parfait et répondre à des normes élevées. (CF)
- Critique ou punition en cas d’erreurs. (A)
- Acceptation, sérénité, estime de soi inconditionnelle (B) - Punitivité
- Les erreurs doivent être sévèrement punies – chez moi et chez les autres. (CF)
- Aucune indulgence ; la punition est nécessaire. (A)
- Pardon, tolérance, compassion (B)
Tout comme l’intensité individuelle d’un schéma spécifique (allant de formes légères à des formes pathologiques) peut varier, la combinaison de plusieurs schémas simultanés peut également fortement différer entre les individus.*6
Que sont les styles de coping inadaptés ?
"Inadapté" signifie quelque chose comme "mal adapté" ou "inapproprié", ce qui implique une certaine dysfonctionnalité pour les schémas inadaptés lorsqu’il s’agit d’affronter et de gérer, par exemple, des situations de stress. Bien qu’un comportement d’adaptation dysfonctionnel soit impliqué, celui-ci est néanmoins distingué du schéma lui-même et compris plutôt comme étant dirigé par le schéma.
En se référant à Jeffrey Young, on distingue trois styles typiques de coping inadapté qui – comme mentionné – n’appartiennent pas au schéma en soi, mais suivent comme des réactions à celui-ci et peuvent aussi changer au cours de la vie :
- Évitement (Flight) : Le style d’évitement consiste à faire face en évitant ou en fuyant l’activation complète du schéma inadapté (EMS). Des exemples typiques incluent l’évitement ouvert ou la fuite de personnes, lieux, activités ou situations qui pourraient déclencher le schéma, ainsi que des actions qui anesthésient ou distraient de l’excitation émotionnelle désagréable – comme la consommation de drogues, d’autres comportements compulsifs, l’automutilation ou le détachement émotionnel.
- Surcompensation (Fight) : Le style de lutte signifie qu’une personne répond à la menace d’activation du schéma en "ripostant", d’une certaine manière, au message central de l’EMS. Autrement dit : penser, ressentir et agir comme si le contraire du schéma était vrai. Des auteurs plus récents ont également appelé ce style de coping « inversion de schéma ». Exemple : une personne avec un schéma d’Imperfection/Honte pourrait surcompenser en affichant de l’arrogance et en se comportant comme si elle était supérieure aux autres (soit l’opposé du sentiment d’infériorité).
- Soumission (Freeze) : Le style de soumission implique la résignation face au schéma – le message central de l’EMS est accepté et la personne se comporte comme s’il était vrai (les croyances fondamentales, attentes et émotions/cognitions associées sont donc activées). Exemple : une personne avec un schéma d’Abandon/Instabilité pourrait se résigner en recherchant ou en entretenant des relations instables (en croyant qu’aucun partenaire ne pourra jamais fournir de manière fiable une disponibilité émotionnelle et physique). Ces personnes peuvent croire qu’elles « ne devraient rien attendre de mieux ». Alternativement, la soumission peut aussi se produire dans une relation par ailleurs saine – par exemple en cherchant constamment à être rassuré ou en contrôlant le partenaire, parce qu’elles "croient" au schéma qui dit : « Tôt ou tard, mon partenaire me quittera » – même s’il n’existe aucune preuve objective.*7
Pour la consommation de tabac, le style d’évitement semble particulièrement pertinent, car le comportement de consommation peut être compris ici comme une « fuite » ou une « distraction » de l’activation complète de l’EMS et comme un « affaiblissement » de l’excitation émotionnelle désagréable grâce à l’effet calmant de la nicotine ; bien qu’il existe des cas concevables où le tabagisme pourrait également s’expliquer par les deux autres styles de coping inadaptés.
Exemple fictif d’un fumeur
Avec un exemple fictif d’un joueur de football qui, dans certaines situations de stress, se tourne inévitablement vers la cigarette, il s’agit maintenant d’illustrer comment le schéma SORCK permet de comprendre une analyse comportementale horizontale, comment les dynamiques psychosociales favorisant le tabagisme peuvent être clarifiées et comment des techniques d’auto-assistance peuvent finalement en être dérivées.
Important : Bien que cela ne puisse en aucun cas être comparé à une thérapie cognitivo-comportementale professionnelle, cela peut néanmoins servir, de manière superficielle, de guide ou de conseil.
H, le footballeur qui ne parvient pas à arrêter de fumer :
 |
"H", un footballeur talentueux, se tourne sans cesse vers la cigarette – surtout après les défaites de son équipe, sa consommation devient excessive. - © Image : AdobeStock |
- Stimulus (S): L’équipe de H perd un match important, et H a raté une occasion de but décisive.
- Organisme (O): H n’a jamais vraiment appris à faire face aux défaites et aux pertes. À l’école, il a été désavantagé par un professeur et, lorsqu’il a exprimé le souhait d’étudier un jour, on lui a dit qu’il n’y arriverait jamais. Aujourd’hui, H se sent souvent incapable et pense n’avoir encore rien accompli dans la vie. Cependant, au football, il se sent particulièrement valorisé lors des succès et apprécie d’être respecté par ses coéquipiers – cela lui donne confiance et estime de soi. Néanmoins, il est généralement très nerveux avant un match, craint de mal jouer, pense souvent être inférieur à ses adversaires et redoute ce qui pourrait arriver si son équipe perdait "à cause de lui" (par exemple, en marquant contre son camp). Cela s’est effectivement produit la saison précédente, après quoi son entraîneur l’a sévèrement critiqué devant ses coéquipiers. En dehors du football, il sort parfois avec ses coéquipiers, dont certains fument et disent que cela les détend.
- Réaction (R): Après la défaite, H a honte, se sent incapable lors de l’analyse avec l’entraîneur et pense qu’il échouera de nouveau au prochain match. Il se voit comme un mauvais joueur et pense qu’il pourrait désormais être indésirable dans l’équipe parce qu’il a manqué l’occasion. Il ressent également des palpitations et de l’anxiété. Ensuite, il refuse d’aller dîner avec ses coéquipiers et veut seulement quitter le terrain. Chez lui, il prend une cigarette pour se distraire grâce à l’effet de la nicotine, et plus il fume, plus il semble se détendre.
- Contingence (K): Éviter le contact avec ses coéquipiers et fumer s’est déjà avéré être une stratégie pour H après plusieurs défaites.
- Conséquence (C): Après de telles défaites, éviter le contact avec ses coéquipiers aide H à échapper à d’autres sentiments et pensées négatives. De plus, fumer lui permet de se distraire et de se détendre grâce à l’effet de la nicotine. Cela atténue son malaise, ses émotions et pensées négatives. À long terme – et H le sait – fumer pourrait entraîner une baisse de performance au football et des conséquences sur la santé. Mais pour l’instant, cette stratégie fonctionne encore pour lui.
On peut ici mettre en relation, dans le schéma SORCK, des stimuli clés spécifiques, des schémas inadaptés et un style de coping inadapté avec certaines conséquences renforçant le tabagisme :

© Image : Snuzone
On voit ainsi ce qui précède l’acte de fumer, comment le tabagisme est intégré dans un réseau de dynamiques psychosociales, et comment le comportement tabagique est alimenté en tant que style de coping inadapté (avec les conséquences positives associées).
À partir de cela, on peut maintenant dériver une mesure d’auto-assistance comportementale et une autre cognitive, axées sur l’arrêt du tabac. Pour rester concret, on continuera à s’appuyer sur l’exemple de H.
>> Cela pourrait aussi vous intéresser : Que ce soit au hockey sur glace ou au football – pourquoi le snus est-il si populaire dans le sport ?
Une méthode comportementale : la satisfaction ciblée des besoins plutôt que fumer
Fumer offre à H, dans le sens d’un style de coping d’évitement inadapté, la possibilité d’anesthésier l’excitation émotionnelle désagréable. Cela fonctionne car la nicotine induit un état légèrement euphorique et relaxant – pour en savoir plus, voir : Effets du snus.
Lorsque H prend conscience du fonctionnement enchevêtré de son comportement tabagique dans le cadre du modèle SORKC, il peut ensuite se concentrer sur les besoins de ses schémas inadaptés (dans la variable organisme) et rechercher spécifiquement des comportements alternatifs (observables) (pour la variable réaction) qui, en satisfaisant ces besoins de manière plus durable, conduisent à une réduction des composantes émotionnelles et cognitives désagréables (dans la variable conséquence).*7
Les besoins sous-jacents aux schémas inadaptés de H sont :
- Expériences de réussite, confiance en soi
- Amour, respect et estime de soi
La difficulté réside dans le fait que H doit envisager des actions possibles (et connues de lui) qui peuvent satisfaire ces besoins. Cela peut sembler assez difficile et, en pratique, le processus de mise en œuvre de tels comportements à la place du tabagisme paraît souvent complexe. En outre, tous les besoins fondamentaux ne sont probablement pas satisfaits de manière égale. Néanmoins, cela peut représenter une opportunité pour H d’utiliser consciemment son répertoire comportemental contre un style de coping d’évitement inadapté lié au tabagisme.
Dans le cas de H, il existe en fait trois activités concrètes qu’il connaît déjà de lui-même et qui peuvent facilement être utilisées comme futures réactions observables au lieu de fumer – pour contrer les réactions émotionnelles et cognitives désagréables (non observables) déclenchées par une défaite au football dans la variable réaction. Les passe-temps suivants procurent à H des expériences de réussite, de la confiance en soi et de l’estime de soi à parts égales :

Le diagramme montre quels passe-temps donnent à H des expériences de réussite, de la confiance en soi et de l’estime de soi. - © Image : Snuzone
Si la satisfaction des besoins par les différents passe-temps variait en intensité, cela pourrait être illustré par des segments de cercle de tailles différentes. On pourrait ainsi estimer l’efficacité potentielle selon les cas. Alternativement, une évaluation peut aussi se faire par une attribution de points sur une échelle de 1 à 10.
Pourquoi et comment cette méthode comportementale est-elle efficace ?
Grâce aux conséquences cognitives et émotionnelles positives attendues, qui peuvent être obtenues par la satisfaction forcée des besoins avec de telles activités (passe-temps), on agit déjà dans la variable réaction afin de compenser les réactions émotionnelles et cognitives inadaptées (non observables) déclenchées par une défaite au football. Cela permet de remplacer spécifiquement le comportement de tabagisme par des alternatives qui privent la cigarette de son but de relaxation et de distraction. Les composantes cognitives et émotionnelles positives de la satisfaction des besoins s’opposent aux composantes négatives des schémas inadaptés et les atténuent (dans la variable conséquence) en termes de relaxation et de distraction également.
On peut donc contrer délibérément le tabagisme afin de lui « voler » son but – à savoir la distraction, la détente, l’atténuation de l’excitation émotionnelle et cognitive désagréable. Les composantes cognitives et émotionnelles positives évoquées délibérément par la satisfaction des besoins ne remplissent pas seulement le même objectif que le tabagisme, elles réorientent même les réactions (non observables) issues des schémas inadaptés vers du positif ; les composantes négatives disparaissent donc. Ainsi, le style d’évitement inadapté peut être neutralisé et le comportement de tabagisme orienté vers un but peut être empêché/arrêté à l’avenir. En conséquence, dans la variable conséquence, apparaît une récompense analogue à celle du tabac, mais la punition du tabagisme disparaît en plus (par exemple, une baisse de performance à long terme, etc.).
Remarque : H ne tombe donc pas dans un style de coping de lutte, mais peut plutôt, en satisfaisant les besoins fondamentaux de ses schémas inadaptés, étouffer dans l’œuf la réaction de coping défavorable « fumer » et en même temps affaiblir les croyances et attentes fondamentales des EMS. Dans tous les cas, H gagne ainsi un ralentissement du style d’évitement qui alimente le tabagisme et, par conséquent, une alternative saine. Par ailleurs, grâce à de tels comportements alternatifs satisfaisant ses besoins fondamentaux, H peut à l’avenir réduire une certaine pression de consommation psychologiquement motivée, à laquelle il s’était conditionné par la régularité de la « réponse tabac » à la « situation de défaite » visible dans la variable contingence.
Une méthode cognitive : la technique des 7 colonnes
Une autre technique d’auto-assistance est la technique dite des 7 colonnes. On parle ici d’une méthode cognitive, car elle se concentre spécifiquement sur les composantes cognitives des styles de coping inadaptés. En principe, dans le cadre d’un protocole de pensées, on identifie les « pensées automatiques », qui apparaissent à la suite d’une (partielle) activation des schémas inadaptés dans la variable réaction. Ensuite, sous forme de colonnes, on recueille des « preuves » à l’appui, des « contre-preuves » et des « pensées alternatives et équilibrées » – dans le but d’atténuer les conséquences émotionnelles de ces « pensées automatiques ».*8
Dans le cas de H, de telles pensées automatiques sont : « Avoir échoué, échouer de nouveau à l’avenir et être indésirable dans l’équipe. » Appliquée à cela, la technique des 7 colonnes se présente ainsi :

© Image : Snuzone
Pourquoi et comment cette méthode est-elle efficace ?
Comme on le voit dans la colonne 7, cette méthode vise à se détendre et à ralentir les réactions inadaptées. Ce que le tabagisme permet – à savoir atténuer la honte, le sentiment d’incapacité et la nervosité – peut donc aussi être atteint avec la technique des 7 colonnes. L’efficacité de cette méthode cognitive peut être décrite de manière similaire à la méthode comportementale mentionnée, en ce sens que le tabagisme est privé de son but. La réaction d’évitement inadaptée du tabagisme est ainsi neutralisée, car elle n’est plus nécessaire. Car, si la détente et la distraction/l’atténuation de l’excitation cognitive et émotionnelle sont obtenues autrement, la nécessité de fumer disparaît – on n’a donc plus besoin de « fumer ce qui peut s’évaporer autrement ».
Contrairement à la méthode comportementale, cette méthode cognitive peut être intériorisée de telle manière qu’elle agit plus rapidement dans la variable réaction via des processus purement cognitifs. En fait, il vaut mieux dire : [...] via un processus global métacognitif, puisqu’il s’agit ici d’un processus de réflexion qui superpose un schéma de pensée appris aux pensées survenues, et qui devient efficace dans le sens d’une surveillance métacognitive et d’une autorégulation.
Combinaison de techniques d’auto-assistance comportementales et cognitives comme clé du succès
Les deux techniques d’auto-assistance mentionnées – lorsqu’elles sont appliquées en combinaison – offrent désormais à H les outils nécessaires pour enfin se débarrasser de la « réponse tabagique » défavorable dans les situations de stress connues d’une défaite au football.
Nota bene : Les deux techniques d’auto-assistance dérivées peuvent aider comme remèdes maison pour l’arrêt du tabac de la manière décrite, mais elles ne remplacent en aucun cas une psychothérapie professionnelle. L’objectif de cet article était plutôt de sensibiliser au fait que l’arrêt du tabac n’est pas difficile uniquement en raison de possibles symptômes de sevrage, mais que des dynamiques psychosociales peuvent également jouer un rôle essentiel. L’analyse comportementale situationnelle décrite ne peut donc être comprise que comme une aide à l’orientation, visant à encourager l’autoréflexion. Les techniques d’auto-assistance qui en sont dérivées ne peuvent donc être comprises que comme des conseils.
>> Cela pourrait aussi vous intéresser : Sevrage tabagique facilité
-----------------------------------------------
Sources (consultées pour la dernière fois le 08.09.25) :
*1 https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/verhaltensanalyse
*2 https://flexikon.doccheck.com/de/SORKC-Modell
*3 https://schematherapie-rhein-ruhr.de/schemata-nach-j-young/
*4 https://www.therapie.de/psyche/info/therapie/schematherapie/schemata/
*5 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Thérapie des schémas : un guide pratique. Beltz Verlag.
*6 https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-621-28224-6.pdf
*7 https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-guide-to-schema-therapy/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1 ; en particulier : https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1/9781108927475c1_1-15.pdf/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes.pdf
*8 https://ulb-dok.uibk.ac.at/download/pdf/7714137.pdf